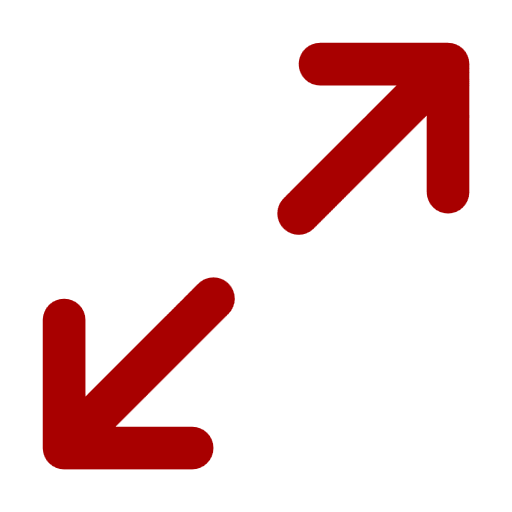 Projections d'un polyèdre régulier
Projections d'un polyèdre régulier
Introduction
Dans ce billet on s'intéresse à l'exercice suivant. Exercice que le lecteur est invité à chercher avant de lire plus loin ! La résolution doit se faire si possible sans calcul.
— Dans l'espace usuel de dimension \(3\), on considère un polyèdre régulier, ainsi qu'un plan \(\P.\) On note \(S\) la somme des carrés des longueurs des arêtes du polyèdre, et \(S_{\P}\) la somme des carrés des longueurs des projections orthogonales des arêtes sur \(\P\). Montrer que \(S_\P/S=2/3\) (et par conséquent ne dépend pas de \(\P\)). Généraliser.
Avant d'en donner une solution, commençons par un énoncé plus simple qui va aider à comprendre l'idée principale : la sphéricité d'un ellipsoïde d'inertie est en quelque sorte la forme géométrique du lemme de Schur.
— Dans l'espace usuel de dimension \(3\), soit \(\S\) l'ensemble des sommets d'un polyèdre régulier, et \(\D\) une droite passant par le centre du polyèdre. Montrer sans calcul que la somme \(\dsum_{s\in \S}d(s,\D)^2\) ne dépend pas de \(\D\).
Un physicien donnerait une solution immédiate de l'ex. 2 consistant à remarquer que \(\sum_{s\in
\S}d(s,\D)^{2}\) est le moment d'inertie de \(\S\) par rapport à \(\D\) (après avoir affecté à chaque
sommet une masse ponctuelle égale à 1), et que l'ellispoïde d'inertie est une sphère par raison de
symétrie
. On va tout d'abord formaliser ce dernier argument correctement, c'est-à-dire de façon
intrinsèque (sans utilisation de coordonnées).
On remplacera les points par des vecteurs en vectorialisant au centre du polyèdre. Dans
la suite \(E\) désigne donc un espace vectoriel euclidien de dimension \(n≠0\). Le produit scalaire est
noté \((\cdot\ps \cdot)\). Étant donné un s.e.v. \(F\), \(p_F\) désigne le projecteur orthogonal sur \(F\).
Étant donné un ensemble \(A\subset E\), on dit qu'une isométrie \(g\) est une
Tout d'abord l'argument de symétrie repose sur le fait qu'aucune direction n'est
privilégiée
, ce qui se traduit par la définition suivante : on dira qu'un ensemble de vecteurs
\(A\) d'un espace euclidien
Il se trouve que c'est effectivement le cas pour un polyèdre régulier :
— Dans un espace euclidien de dimension \(3\), l'ensemble \(\S\) des sommets d'un polyèdre régulier possède suffisamment de symétries.
Remarquons que si \(F\) est un s.e.v. de \(E\) et \(x\in E\) alors \(d(x,F)=||p_{F^\ortho(x)}||.\) L'énoncé de l'ex. 2 est alors un cas particulier du théorème suivant, lequel fournit en outre la valeur \(\sum_{s\in \S}d(s,\D)^2=(2/3)\times \sum_{s\in \S}||s||^2.\)
— Soit \(E\) un espace euclidien et \(A\subset E\) un ensemble fini. Si \(A\) possède suffisamment de symétries, alors pour tout s.e.v. \(F\) de \(E\) on a: \[\dsum_{a\in A}||p_F(a)||^2={\dim F\over \dim E}\>\dsum_{a\in A}||a||^2\,.\]
l'opérateur d'inertie
dual
de \(A:\) si \(||x||=1\) alors \((u_A(x)\ps x)\) est le moment d'inertie de \(A\) par rapport à
l'hyperplan \(x^\perp\)., et a donc une valeur propre \(\lambda\). Mais \(u_A\) commute avec toutes
les isométries de \(A:\) si \(g\) est une telle isométrie, alors
Ensuite pour tout \(e\in E\) tel que \(||e||=1,\) on
a
On peut maintenant facilement étendre le th. 1 à un résultat plus général permettant de
traiter non seulement l'ex. 2 mais aussi l'exercice initial ainsi que plusieurs autres situations
géométriques analogues. Il suffit de remplacer l'utilisation d'un ensemble fini de vecteurs par
celle d'une famille finie. Soit \(I\) un ensemble (d'indices
). On suppose donnée une action
\((g,i)\mapsto g\cdot i\) du groupe orthogonal \(O(E)\) sur \(I\). On dira qu'une famille de vecteurs
\((x_i)_{i\in I}\) est
— Soit \(f=(x_i)_{i\in I}\) une famille admissible de vecteurs dans un espace euclidien \(E\) et \(J\subset I\) un ensemble fini ayant suffisamment de symétries. Pour tout s.e.v. \(F\subset E\) on a : \[\dsum_{i\in J}||p_F(x_i)||^2={\dim F\over \dim E}\>\dsum_{i\in J}||x_i||^2\,.\]
C'est la même preuve que pour le théorème 1 en considérant cette fois \(u_f(x)=\sum_{i\in I}(x\ps x_i)\,x_i\) au lieu de \(u_A(x)=\dsum_{a\in A}(x\ps a)\,a.\)
a Le th. 2 redonne le th. 1, lorsqu'on l'applique à \(I=E\) et à la famille indexée par l'identité.b L'ex. 1 se résout en prenant- \(I=E\times E\) et, pour \((a,b)\in I,\) et \(g\in O(E),\) \(g\cdot (a,b)=(g(a),g(b)).\)
- \(x_{(a,b)}=b-a.\) L'admissibilité de \((x_{(a,b)})\) provient de la linéarité de \(g.\)
- \(J=\{(a,b)\in E\times E\,,\>\{a,b\}\) est une arête du polyèdre\(\}\) (On se donne donc deux couples \((a,b)\) et \((b,a)\) pour chaque arête \(\{a,b\}\) telle que \(a≠b\)). De façon évidente \(J\) possède suffisament de symétries, puisque toute isométrie du polyèdre envoie une arête sur une arête, et par conséquent est une isométrie de \(J.\)
c Un polyèdre n'a pas besoin d'être régulier pour vérifier la propriété de l'ex. 1 : il suffit qu'il ait même groupe d'isométries qu'un polyèdre régulier Il suffit même que son groupe d'isométries contienne celui d'un polyèdre régulier.. On peut par exemple l'obtenir par troncature d'un polyèdre régulier (par exemple, l'énoncé de l'ex. 1 subsiste pour des polyèdres archimédiensVoir par exemple la page traitant des polyèdres archimédiens sur Wikipedia ou sur Mathcurve.) ou au contraire en faisantpousser
d'autres polyèdres sur les faces, par exemple en appuyant sur chaque face d'un polyèdre régulier une pyramide ou un prisme de hauteur fixée.d Appelonssquelette tout ensemble fini \(J\subset E\times E.\) À partir des squelettes des arêtes de polyèdres réguliers, ou de squelettes donnés par la remarque c), on peut en construire beaucoup d'autres vérifiant la propriété de l'ex. 1 en remarquant que l'ensemble de ces squelettes est stable par translations et unions disjointes.